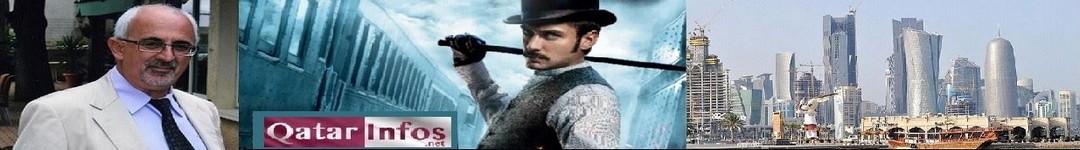Les débuts de l’agriculture aux États-Unis remontent à l’époque où les Amérindiens étaient les seuls habitants de ces terres. Ils pratiquaient déjà la culture du blé, de l’orge, du cacao et des tomates, entre autres. Ce savoir agricole se transmettra et évoluera avec l’arrivée des Européens et le développement des colonies sur le continent nord-américain.
Une lutte sans merci pour s’approprier les territoires
Voici ce qu’on trouve sur Wikipédia sur les débuts de l’agriculture aux USA. L’agriculture sur le territoire des actuels États-Unis commence très tôt, dès l’époque où y vivent seuls ses premiers occupants : les Amérindiens. Ils cultivent notamment du blé et de l’orge mais aussi du cacao, des tomates… Elle s’intensifie réellement avec l’arrivée des esclaves africains au XVIIe siècle. Depuis le XIXe siècle, la Corn Belt (« ceinture de maïs ») est la principale zone agricole de ce pays – la Sun Belt étant connue pour ses fruits.
Après la guerre de Sécession, les grands propriétaires fonciers s’emparent graduellement de la plupart des terres au détriment des petits colons au Texas et au Kansas. Entre 1880 et 1884, les grands propriétaires, organisés en véritables trusts basés principalement à Boston et à New York, prennent possession de près de cinquante millions d’acres. Ils organisent des groupes de voleurs de bétail afin de harceler et ruiner les petits éleveurs ; près de trois millions de têtes de bétail sont volées aux Amérindiens dans les années 1860. Selon les estimations de l’historien Oscar Osborn Winther, au moins 50 % des hors-la-loi étaient des employés des grands propriétaires. Ils obtiennent par ailleurs la collaboration du Parlement, qu’ils contrôlaient au Texas et au Kansas.
En 1880, les États-Unis possèdent quarante millions de têtes de bétail. Nombre de petits colons n’ont pas les moyens de s’offrir des bovins mais peuvent en revanche faire de l’élevage de moutons. À partir des années 1880, les grands éleveurs de bétail se lancent dans une « guerre du mouton » qui se prolonge pratiquement jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les cow-boys organisaient des expéditions contre les éleveurs de moutons ; les bêtes sont généralement empoisonnées ou abattues, ou dans certains cas précipitées du haut des falaises. Pour les propriétaires de bovins, il s’agit d’une question d’économie : sans mouton, le prix du bœuf monterait.
Une autre méthode employée par les grands éleveurs pour ruiner les indépendants et les petits est la pose de clôtures de fil de fer. Ces clôtures permettent d’isoler les points d’eau pour assoiffer le bétail. En 1874, cinq tonnes de fil de fer barbelé sont mises en place, puis 127 tonnes en 1876 et 3 600 tonnes en 1880. En réaction, des groupes de petits éleveurs s’organisent pour cisailler les clôtures de nuit ; au Texas, vingt millions de dollars de clôtures sont détruites entre 1880 et 1885. La Chambre des représentants du Texas rend en 1884 la destruction de clôtures un crime punissable de cinq ans d’emprisonnement. Le fait de clôturer à tort, même en connaissance de cause, n’est puni que d’une amende.
Dans les années 1930, l’agriculture subit une crise majeure de surproduction et de paupérisation des agriculteurs (ou farmers). Le Dust Bowl (« Bol de poussière »), des tempêtes de poussière et une sécheresse, provoque une catastrophe écologique qui touche, pendant près d’une dizaine d’années, la région des grandes plaines. Ces tempêtes détruisent toutes les récoltes, dépouillent les champs de leur terre (érosion), la remplaçant par de la poussière, ensevelissent habitations et matériel agricole et jettent des milliers de fermiers sur les routes, en direction de l’ouest. Dans Les Raisins de la colère, le romancier John Steinbeck décrit de façon poignante cette période de l’histoire américaine. La crise écologique provoquée par le Dust Bowl conduit le gouvernement américain à créer le Soil Conservation Service (en), appelé aujourd’hui Natural Resources Conservation Service (en), organisme chargé de la sauvegarde des ressources naturelles et de l’environnement.
Sur les recommandations d’Henry Wallace, l’administration Roosevelt entreprend de protéger les agriculteurs contre les aléas du marché en distribuant des subventions fédérales et en contrôlant la production. Le président Roosevelt fait voter la création d’une Agence agricole et des lois pour assurer la régulation de l’offre de produits agricoles. Le 12 mai 1933, l’Agricultural Adjustment Act fut promulgué. On décide ainsi de réduire la production pour faire remonter les cours agricoles. Pour cela une grande partie des récoltes et des réserves sont détruites ; la réduction des surfaces cultivées est encouragée par une politique d’indemnisation. Les dettes des agriculteurs furent rééchelonnées (Farm Credit Act, 16 juin 1933).
Les premiers résultats, au bout de trois ans, sont encourageants, puisque le revenu des agriculteurs augmente. Aussi, l’interventionnisme étatique dans le secteur primaire est amorcé.